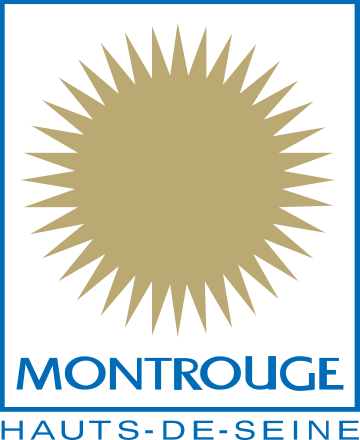Il était une fois... L'Hôtel de Ville
Un territoire en évolution
À son origine, Montrouge était composée de deux agglomérations : le Petit Montrouge (devenu le 14e arrondissement de Paris) et le Grand Montrouge, un hameau situé entre le boulevard Romain Rolland et l’avenue Verdier. À partir de 1840, ces deux agglomérations sont physiquement séparées par l’enceinte de Thiers. C’est en 1860 que le Petit Montrouge, qui connaît un essor important dû à l’implantation de fabriques, se voit annexer par Paris à la demande expresse de Napoléon III. La ville de Montrouge, dont le territoire est alors réduit de 350 à 105 hectares, passe de 20 000 à 3 000 habitants et son Hôtel de Ville, datant de 1852, deviendra celui du 14e arrondissement de Paris. En 1875, le territoire s'agrandit de quelques parcelles prises sur les communes d’Arcueil, de Bagneux, de Châtillon et de Gentilly afin de fixer les limites définitives de la ville. Il faut alors réorganiser la commune en fonction et offrir aux quelque 5 000 Montrougiens de l’époque la construction d’une mairie adéquate.
Construction et agrandissements
En 1876, le projet de construction est officiellement lancé par la Municipalité. L’architecte du département Jacques-Paul Lequeux est chargé de réaliser ce nouvel édifice sur l’emplacement du château du Duc de la Vallière (milieu du XVIIIe siècle), en face de l’ancienne église Saint-Jacques. L’idée est de donner naissance à un pôle majeur de la vie municipale et au futur centre-ville.
L’édifice sera conçu en brique et en pierre, surmonté d’un campanile, en hommage à l’ancien château. Après trois ans de travaux, le nouvel Hôtel de Ville de Montrouge est inauguré en août 1883. Les services de la Ville se développant, le bâtiment se révèle cependant rapidement trop petit et il est décidé de construire deux ailes supplémentaires. Confiées à l’architecte Jules Baboin, elles seront inaugurées en 1903 et viendront tripler le volume initial du bâtiment. Dans le cadre de ces travaux d’agrandissement, la Municipalité fait aménager les jardins de l’Hôtel de Ville.
Après la Première Guerre mondiale, la population de la ville augmente considérablement, notamment en raison de la proximité de Paris. En 1930, elle atteint les 30 000 habitants. Les infrastructures se développant, la Municipalité fait le choix de la création d’un centre administratif, confié à l’architecte Henri Decaux et inauguré en 1934. L’ensemble des services administratifs (police, tribunal, garage, salle des fêtes) est alors regroupé dans ce nouveau bâtiment, dont la particularité est la présence d’un Beffroi de 43 mètres de haut.
Aujourd’hui, l’Hôtel de Ville accueille principalement les bureaux du Maire et des adjoints, la salle du Conseil où les décisions importantes pour la Ville sont prises et la salle des Mariages où 200 mariages sont célébrés par an.
Un écrin pour des œuvres précieuses
L’intérieur de l’Hôtel de Ville abrite aujourd’hui encore des œuvres remarquables inscrites à l’inventaire général des monuments et richesses artistiques de la France :
- Deux cheminées en faïence et émail polychrome (dans la salle des Mariages et la salle opposée de l’aile Nord, présentes dès 1883 dans la partie centrale de l’Hôtel de Ville et déplacées dans chaque aile lors de l’agrandissement de 1903) ;
- Le bureau en chêne verni de la salle des Mariages (sculpté vers 1903) ;
- Le buste de Marianne de Lorenzi (vers 1980), installé dans la salle des Mariages.
- Diverses fresques : Les Âges de la vie de Victor Tardieu (1920, plafond de la salle de l’aile Nord) ; Fiançailles, noces et famille de Henri Jamet (1914, plafond de la salle des Mariages) ; L’Hyménée et la justice de Théobald Chartran (1886, réalisée dans l’ancienne salle des Mariages, devenue aujourd’hui la salle du Conseil municipal) ; Les Carrières à Montrouge de Paul Schmitt (ensemble de deux fresques situées dans l’escalier d’honneur et réalisées en 1899 et 1900).