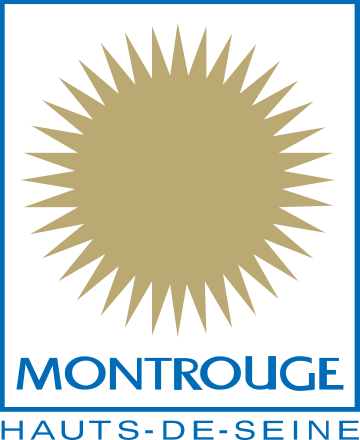L’église Saint-Jacques le Majeur
- 57 m de long
- 13,25 m : la nef
- 20 m : la hauteur sous plafond
- 8 millions d'euros
- 4 ans de travaux
Depuis 2006, l’église Saint-Jacques le Majeur, patrimoine de la Ville de Montrouge, est inscrite au titre des Monuments Historiques.
Sa silhouette aux allures de bâtiment industriel participe au paysage urbain de Montrouge. L’église Saint-Jacques le Majeur étant très dégradée, une longue et complexe rénovation menée par la Ville de Montrouge entre 2013 et 2017 était nécessaire. Elle lui a redonné son lustre d’origine et même plus...
Aujourd’hui, la regarder c’est la découvrir autrement.
Y entrer, c’est plonger dans un intense bain de lumière et de couleurs.
- 1933-1937 : Construction
- 1947-1953 : Réalisation de la décoration
Un peu d’histoire & beaucoup d’architecture
Des édifices successifs
Plusieurs églises se sont succédé à l’angle de l’avenue de la République et de la rue Gabriel Péri, où la célébration du culte semble avoir eu lieu dès le XIIIe siècle. Ainsi, l’église paroissiale en place pendant la période révolutionnaire (période à laquelle les paroisses sont érigées en communes), fortement affaiblie, est interdite au public en 1809 pour cause de vétusté. Après sa démolition, une nouvelle église est reconstruite de 1823 à 1828. On y entre par un emmarchement rectangulaire qui déborde largement sur le trottoir. Le détail a son importance car, dans les années 1930, le principal carrefour de Montrouge fait l’objet d’un vaste aménagement pour faire face à l’augmentation de la population et à la densité croissante de la circulation. L’église est alors frappée d’un arrêté d’alignement afin de permettre l’élargissement de la Voirie. La Municipalité et le Diocèse conviennent de sa démolition et de la construction d’un nouvel édifice, plus vaste, mais en retrait par rapport à l’église existante. Le dimanche 5 décembre 1937, le cardinal Verdier procède à la bénédiction de la nouvelle église Saint-Jacques-le-Majeur.
Architecture avant-gardiste
Le projet, confié à l’architecte Éric Bagge, grâce à l’Œuvre des Chantiers du Cardinal, est conçu en béton armé – le chantier sera réalisé par l’un des spécialistes de ce matériau, la Société des Grands Travaux en béton armé. L’ossature du bâtiment, novatrice pour une église, est assurée par une charpente en béton armé et des portiques articulés qui dégagent sous eux une hauteur de 20 mètres et déterminent les volumes de la nef et du chœur, dont l’ensemble mesure 52 mètres de long et 13 mètres de large. L’impression d’unité qui se dégage du volume intérieur est assurée par l’effacement presque total aussi bien des portiques que des nervures du mur rideau, constitué de plaques de béton préfabriquées, et par le gabarit uniforme des dalles de remplissage des murs et des dalles du plafond.
À l’intérieur de ce vaste volume, seul le chœur est mis en valeur, à la fois par sa taille imposante (qui représente un quart de l’ensemble du vaisseau) et par les quelques marches qui y mènent. La lumière, quant à elle, n’éclaire la haute nef sous son plafond plat que par une bande de vitraux de deux mètres de hauteur, placée immédiatement au tiers de la hauteur, laissant dans la pénombre la partie haute, alors que le chœur est davantage éclairé par les vitraux du fond et de manière indirecte par les vitraux latéraux. La couleur à dominante jaune de ces vitraux latéraux, invisibles de la nef, et les lambris de travertin jaune donnent de la chaleur à ce chœur où tout, comme dans l’ensemble de l’édifice, n’est que lignes droites se coupant à angles droits.
Une conception composite
À l’intérieur, l’architecture laissait à nu d’immenses pans de murs : celui du chevet plat du chœur, ceux de la galerie de circulation au nord et divers murs des chapelles. À partir de 1947, sous la direction de Robert Lesbounit, directeur de l’École municipale de dessin du boulevard Montparnasse, de jeunes élèves de milieux modestes réalisent collectivement le décor peint, illustrant sur 300 mètres carrés les scènes de la vie de saint Jacques.
À l’extérieur, les plans d’Éric Bagge prévoyaient initialement un baptistère et une chapelle des morts entourant de part et d’autre un clocher de 55 mètres de hauteur, mais la construction de ces éléments fut interrompue par la Seconde Guerre mondiale.
Ce n’est qu’en 1981 que le père Dufourmantelle, chancelier de l’évêché de Nanterre, demande à l’architecte Henri Martin d’achever la façade. Ce dernier propose alors un décor dans l’ossature en béton, solution la plus modeste et la plus respectueuse de l’œuvre initiale – très vite, l’idée d’un grand mouvement vertical venant de tous les horizons et convergeant vers le haut, telle une prière, sous la forme d’une immense croix, est retenue.
Une rénovation en profondeur, dans les règles de l’art
Lorsqu’en 2013 la Ville de Montrouge, propriétaire de l’église, lance le chantier de restauration, Saint-Jacques le Majeur est en mauvais état : béton altéré, acier corrodé, chauffage déficient, accessibilité limitée… une réhabilitation s’impose ! le chantier est conduit en quatre phases sous la direction de Pierre-Antoine Gatier, architecte en chef des monuments historiques.
2013 : Renforcer l’infrastructure
Les poteaux en sous-sol étant très fragilisés par les résidus pollués d’une ancienne tannerie sur le site, la première phase des travaux a visé à les rénover et à évacuer la terre souillée. Des matériaux de haute qualité technique ont été employés. Les plats carbone de l’église consolident les poutres les plus sollicitées.
2014 : Restaurer l’extérieur
Au programme de la deuxième phase :
réfection des couvertures en zinc et des terrasses, restauration des vitraux, ainsi que des menuiseries métalliques et en bois. La restauration des maçonneries est confiée à Lefevre Rénovation. Soigneusement patinés, ajouts de matières et réparations sont invisibles, une véritable réussite !
2015 : Réhabiliter l’intérieur
Un chauffage par le sol a été installé pour améliorer le confort tout en maîtrisant la consommation et sans altérer l’esthétique. Un narthex de verre a été créé pour servir de sas d’entrée et recevoir le bureau d’accueil. Enfin, les parements intérieurs en ciment ont été nettoyés par cryogénie.
2016 : Restauration des peintures murales
Elle a été menée par l’équipe d’Alice Desprat, conservatrice-restauratrice du patrimoine. Saint-Jacques le Majeur est fin prêt à écrire une nouvelle page de son histoire.
Le saviez-vous ?
L’église Saint-Jacques le Majeur est la propriété de la commune depuis le Concordat de 1801 ; la loi sur la séparation de l’Église et de l’État de 1905 ne changeant pas sa domanialité (qui relève du domaine public). En 1932, la Municipalité décide d’élargir l’avenue de la République et la Grande Rue (rue Gabriel Péri). L’église doit donc être déplacée. C’est à la Ville, propriétaire de l’édifice, que revient l’obligation de re-construction et d’entretien.