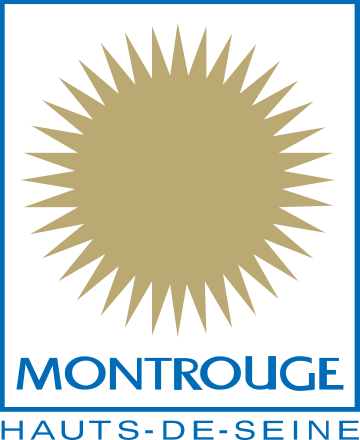Il était une fois... la rue du Stade Buffalo
L’ancien vélodrome Buffalo
Installé initialement à Neuilly, le vélodrome Buffalo fut transféré à Montrouge, à l’angle de la rue Carvès et de l’avenue du Fort, et inauguré le 17 septembre 1922. C’était alors l’un des plus grands stades d’Île-de-France : pouvant accueillir jusqu’à 50 000 spectateurs, il hébergea de nombreuses épreuves de cyclisme, des tournois de boxe et des matchs de football, ainsi que les premières courses de stock-car en Europe (de 1953 à 1957). Également lieu de meetings politiques durant les décennies 1920 à 1940, il connut ensuite des heures plus sombres en servant de camp d’internement des étrangers pendant la Seconde Guerre mondiale.
Pourquoi ce nom ? Le célèbre chasseur de bisons et metteur en scène Buffalo Bill avait franchi le Pacifique en 1889 avec sa troupe de comédiens. Venu jouer son tonitruant spectacle de cow-boys et d’Indiens, le Buffalo Bill’s Wild West Show à Neuilly, lors de l’exposition universelle de Paris, il remporta un grand succès dans l’Hexagone. Le vélodrome Buffalo de Neuilly, construit en 1896, à l’endroit même où il s’était produit, lui rendit ainsi hommage. Par la suite, démonté et remonté pour une seconde vie à Montrouge, il en garda le nom, bien que Buffalo Bill n’ait jamais mis un pied en territoire montrougien !
Du stade à la résidence de Fernand Pouillon
Sous la pression démographique des années 1950, le vélodrome est démoli et l’ensemble du quartier est réaménagé pour répondre aux besoins d’hébergement : la Ville de Montrouge, qui fait l’acquisition du terrain en 1952, y fait alors implanter une crèche, un groupe scolaire et une résidence. C’est le célèbre architecte Fernand Pouillon qui est chargé de concevoir cette cité, entre 1955 et 1957. Il s’agira d’un ensemble immobilier de 466 logements, remarquable par son parc d’une superficie d’un hectare, ses façades de style après-guerre et ses logements traversants, aujourd’hui classé au Patrimoine du XXe siècle (« Architecture Contemporaine Remarquable »).
Les deux immeubles de sept étages sont disposés en forme de L, en bordure de la parcelle. Une tour de sept étages sur pilotis sert de pivot à cette composition complétée par deux petites barres de trois et quatre étages. L’ensemble dessert une vaste cour intérieure aménagée d'un bassin circulaire, de pelouses et d'espaces plantés d'arbres. Les bâtiments sont construits à partir d'une ossature en béton armé avec des façades en pierre de Provence.